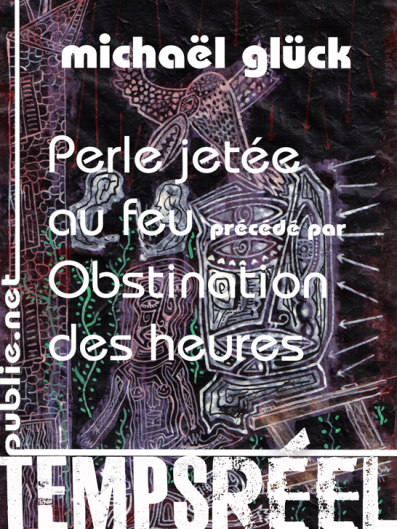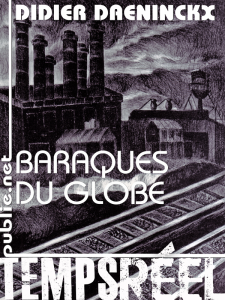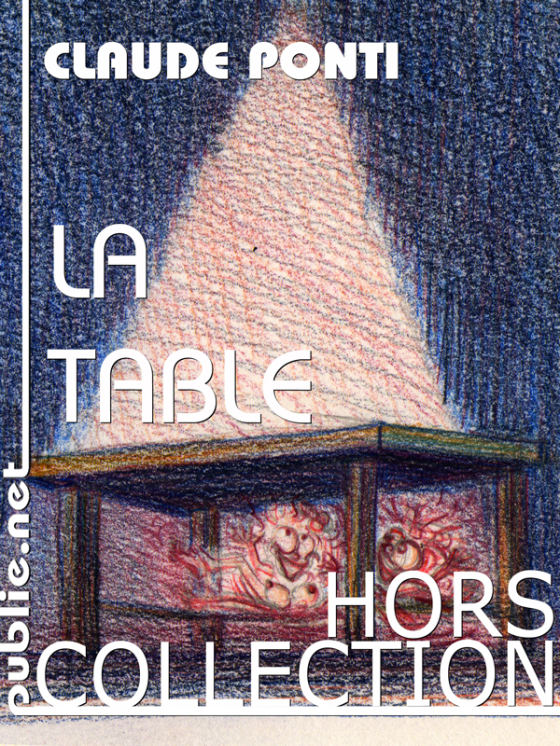-je préviens : ceci est une chronique en forme de jets émotifs-
« perle jetée au feu ne reste que la cendre est une phrase tombée sans prévenir, qui tranche dans l’amorphe, coupe la main qui l’écrit, fait tâche rouge »
Ce texte de Michaël Glück est une Respiration, une Colère.
La mise en page et la place des fragments et césures appuie parfaitement l’intention du texte et son intensité. Comment écrire et brider la pulsion de colère pour qu’elle devienne audible, juguler l’intensité du dégoût, la force de la colère monstrueuse devant les monstres, devant la monstruosité, armes inégales. Que sont des mots pour lutter, notre place où est-elle, nous, humains, qui savons, laissons faire, assistons, ou souffrons, et ceux qui ne peuvent sortir du silence, aujourd’hui, hier, toujours. C’est tout l’enjeu de garder assez de puissance, traversé par ce souffle qu’il faut interrompre, une respiration, reprendre ensuite, raffermi, pour être capable de dénoncer à nouveau, et il faut toute la finesse et la dextérité de Michaël Glück pour y parvenir. Perle jetée au feu, texte rare, où chaque page/fragment de mon exemplaire est surlignée une phrase /expression belle, douloureuse, importante.
« depuis l’enfance j’apprends à compter les morts »
Faire les comptes, les décomptes, d’une voix posée (magnifique lecture-vidéo en fin d’ouvrage sur la version Ipad).
Perle, une petite fille, un quai de gare, une main qui essaie d’en attraper une autre.
« le corps est un volcan qui ne crache pas sa propre langue mais langue plus vieille »
J’ai beaucoup de mal à rédiger une chronique de lecture de Perle jetée au feu, parce que les mots de Michaël Glück me secouent d’émotion sans doute. Peut-être aussi, parce que je rage de voir toujours accolés au terme Poésie les mêmes morts des Lagarde & Michard, alors que des poètes sont vivants, plus que vivants. Que régulièrement j’entends des esprits étriqués, de petits prescripteurs frileux miauler qu’il n’y a plus de poètes de nos jours, auront-ils l’audace de lire ce texte seulement.
Ci-dessous deux extraits, qu’il était difficile de choisir tant ils sont nombreux les passages que je veux conserver :
« disparition
la nuit fraise les dents des morts, creuse dans l’éburnéenne pâleur et là sont-ce écrans, micro-écrans sur lesquels sont projetés les derniers mots, quelque chose qui ressemblerait à l’optogramme, l’impossible dernière image qui aurait brûlé la rétine – ou bien implosion, le récepteur s’autodétruit – rien plus rien ce qui était ou fut s’effondre ou précipite, mais garderait ici mémoire charbonneuse, peu à peu l’hippocampe plonge et ventouse les pupilles, suce les yeux, racle et vide les orbites, il nage dans l’encre des éclipses, personne ne se relèvera d’entre les oubliés, ni les enfouis ne soulèveront la peau des plaines pour engendrer les montagnes, ni la poussière ne retournera au golem, sur les rives de la vlatva ne reviendront que les mots entre disparition et dispersion, perle jetée au feu ne reste que la cendre alors sur le quai de la gare centrale je verrai cette enfant que je n’ai jamais vue, celle qui mains unies derrière le dos longeait les trains d’exil en claudiquant à la façon du marchand ambulant qui lançait vers le ciel gris de l’histoire, pivo pivo qui veut de la bière, de la blonde de la brune de la rousse de la fraîche des goûts et des coups, pleure ne pleure, elle ne pleurait jamais la petite fille sur le quai de la gare centrale de praha »
[…]
« au feu ne reste
que l’encre fleuve et la barque prise dans un siphon de cauchemars, un tourbillon dans lequel la pensée, ce vagabondage, cette rêverie noire se noie, tu m’écoutes, non, tu ne m’entends même pas, c’est la faute aux mots, ne passent pas le seuil, ne franchissent pas la barrière des dents, ne déchirent plus les lèvres, ne font plus trouée dans le visage, chemin vers, tu m’écoutes, les yeux sont ailleurs, tournés vers, tu ne m’entends même pas, au feu ne reste que la cendre »
~>Perle jetée au feu – précédé par Obstination des heures, de Mickaël Glück
sur ~>Publie.net
(chronique initialement parue sur Oeuvres ouvertes, le site de Laurent Margantin)
‘
« Il supportait mal les faiseurs de discours. Il détestait plus que tout être objet de récit. »
Alors, comme on s’approche d’une bête rétive inconnue, le récit se forme et se déforme pour l’atteindre, lui André, et ceux qui l’entourent, l’entourèrent. C’est un ‘décillement’, une gageure, une écriture frontale impossible à laquelle Marie Cosnay se coltine pour stopper une gangrène silencieuse. Ne pas l’écrire reviendrait à ne pas écrire, définitivement.
Le texte s’arrime à des dates, lieux, documents qu’il utilise sans s’y limiter (« Je trouvais des temps parallèles, souples. »… « Penser aux sources remontées, aux pistes suivies, à toutes celles qui m’agrippèrent. »).
L’écrit est posé sur ligne de tension extrême, poésie, histoire, phrases détaillées de précisions, puis bascules, ruptures et embardées, dans l’attention du geste vital exercé.
« Arracher l’idée car je m’y désagrège. Chaque geste : forme compacte. Chaque geste fait un cocon de geste. Arracher ce que je suis, ce que je fus devant, au-dedans, l’arracher, fabriquer avec rien une peau, couvrir. Une pause. Vouloir que rien ne passe. »« Je vivais, c’était par le fils d’André. Lui mourait, fabriquant le berceau de mes poupées. Je ramassai la chose vacante qu’il avait léguée, la figure d’autre chose, j’allai. »
Déjà, au tout début, André n’est pas qu’André. Se déplient à l’intérieur de lui d’autres formes qui prennent vie autonome, chacun portant en miroir plus de figures que lui-même n’en contient ou n’en a conscience. « Du secret insistant dans le bruit des obus, André est tombé amoureux. Le temps n’était pas à savoir de soi-même. La douceur il la trouva inattendue, dans le secret du garçon qui frottait aux siennes ses épaules, le secret il le reçut comme si dans le froid du couloir de boue ils étaient non tous deux, épaules contre épaules, mais quatre – lui et lui-même doublés du garçon et de ce qu’avait le garçon en lui-même. Et de l’homme absent que le garçon aimait. »
Ainsi ce travail passe par contourner, atteindre par la bande, ce qui ne peut être dévoilé clairement, car « si tu le dis je meurs ». Outrepasser l’interdit, le dire, et l’écrire c’est provoquer la mort (avec toute l’étendue de sens du mot ‘provocation’, sa gestuelle suicidaire, pleine de panache, d’énergie vive). Ne pas dire est une agonie lente que la narratrice refuse. Elle fond alors son geste dans une union des vivants et des morts, qu’elle entrelace avec sa voix :
« Au moment le plus fort, au pic du grand repos qui joignait l’inconscience, la morte retrouva un corps, beau, double, simple et défripé, du mien. Nos chairs, dans le cœur de l’alcôve que je préparai pour la fête, se mêlèrent sans que l’on pût savoir de qui étaient la cuisse, le torse soudain fait mâle, la dent, le lobe de l’oreille, le doigt. Je désirai que la mêlée continuât. »
Marie Cosnay travaille et c’est à la fois descente, extraction et remontée. Et l’interrogation première, le mot lui-même pris à sa source comme non-explicite, non-gérable, non-discernable puisque sans genre, un non-dicible qui va s’amplifiant. De l’amour inexprimable entre deux hommes, malédiction silencieuse devant témoin muet. De l’enfant sans nom disparu, fils d’une morte, que l’on retrouve, qu’on ressuscite, mais sans rien prononcer. D’une autre naissance que l’on ne peut nommer ni désigner, comme si le destin s’ingéniait à jouer avec les attaches fines qui nous relient à la parole. De ces liens familiaux noués, quelles sont les tiges qui durent, qui impriment force et sens, quand l’une d’elles ne peut simplement pas parler, sous ‘peine de mort’, et quand une autre ne sait même pas qui être, entre le le, le la, n’est peut-être pas né(e), collée/coincée sur terre dans ses limbes d’enfants-anges privés de ciels, d’enfers, de voix. La narratrice ravaude ses fils, tiges familiales, en teste la résistance, avec la peur qu’ils cèdent mais la certitude qu’il le faut. Repousser les ombres, peut-être les écarter, peut-être les faire fuir, aller, lent voyage vers André. « André, la douceur lui faisait de petits signes, sur les flammes, épaule contre épaule, dans le récit de celui qui ne craignait pas les récits mais se promettait la mort pour un mot alors même que la mort, on lui marchait dessus. »
André des ombres passe aussi par des terres de légendes, Ethiopie, là où une femme marche derrière des machines, une imprimerie et les lettres formées, extraites, envoyées. (« Toutes les vingt secondes les lignes de plomb tombent dans la galée. Les lignes sont posées sur la table d’acier. »)
« La nuit du 24 au 25 mai 1991, quatorze mille personnes quittent Addis Abeba, empruntent le pont aérien qui ramène au pays de Salomon les enfants présumés qu’il eut de la reine aux pieds nus, mordue de connaissance, et les enfants de leurs enfants. Bien avant, en 1923, Alexis, Marie, André et Albertine ont quitté Addis Abeba, et quant à André, venant des bords terrorisés du siècle, il persista à se taire, rangea chaque savoir dans les casiers de son intelligence, casiers qu’il s’efforça de rendre stériles, imperméables. »
Ce serait ironique et grave qu’André des ombres ne soit pas lu et donc réduit au silence, tant le talent et la beauté des phrases de Marie Cosnay s’emploient pleinement à lutter contre. Dans une ultime tension contradictoire, le silence transformé est devenu source, magnifique centre de parole, avec une grâce des moments captés. « D’autres fenêtres sont ouvertes sur des fleuves rougis de tempête, on y appelle au secours. Le chant sonne sur la berge d’en face, l’appel renvoie l’appel. Un cygne blanc passe sous le pont de fer à la recherche de poissons morts. On raconte un chien tombé au fleuve, étouffé sous les ailes du cygne. Derrière les fenêtres protégées l’ennui est blotti. »
–
~> André des Ombres, par Marie Cosnay, éditions Publie.net, collection Reprint
–
Instant T, T de trié, terminé, tendu ? On pense à Tempo, instant de tempo suspendu. A l’intérieur d’une photo et en aller-retour avec la légende de cette photo, le moment, l’Instant T de Louise Imagine dure plus longtemps que prévu.
L’epub provoque une immersion d’entrée avec bande son intégrée (une réalisation de Gwen Català). L’ambiance est grande ouverte : bruits de la vie « calme et tranquille », un chien, des insectes, l’appel sonore d’une campagne reposante, accueillante, disponible, on pourrait s’allonger à l’intérieur.
Au départ une mosaïque de photos assemblées en facettes. Un espace non clos, fragmenté en éclats de sensations. L’Instant T se positionne sur le côté, un écart qui nous place dans une contemplation rare, avec sa stabilité ou son incertitude. Le lecteur lui, n’est pas écarté, devient inclus, spectateur fondu dans l’attente d’un train, la vue d’une ville depuis une hauteur, la réverbération de l’eau sous un pont, l’ombre d’une silhouette au jardin. La légende donne des indices – situations plus ou moins précises, que nous pouvons absorber, pause, pré, gare, entrée de métro – puis s’en dégage comme d’une gangue trop lourde ou trop restrictive pour englober un tout plus large de cette vie qui va (« Quelque part sur Terre »).
L’existence des événements qui précèdent ou suivront se fait trame ou étages d’un mille feuille invisible. L’Instant T les emmène avec lui à la traine, sillage de bateau. Déménagement, naissance, vacances, des détails à peine effleurés nous unissent au parcours, car nul besoin de précision, on nous fait confiance pour reconnaître le retentissement sensible de ces moments arrêtés entre deux passages, deux périodes, deux horizons.
La forme numérique d’Instant T n’est pas une coquetterie ou un jeu technique. Le fait de pouvoir à tout moment revenir à la présentation initiale de la mosaïque des photos pour venir se saisir d’un autre chemin /engouffrement/ répit, accentue l’impression d’un monde à la fois fugitif, ténu et dense. C’est de l’extrême brièveté dont il est question et peut-être de nos choix de halte, de comment on s’y abandonne.
(il me semble qu’une présentation papier, avec l’ergonomie des pages empilées, enfermerait chacune des photos et légendes dans une sorte de cul de sac, une finitude, et que l’on perdrait cette vision globale un peu mouvante, un peu éphémère, et les interrogations qu’elle porte)
–
L’Instant T de Louise Imagine, postface d’Isabelle Pariente-Butterlin
maquette et réalisation epup Gwen Català
Collection HORIZONS
sur Publie.net
(chronique initialement parue sur Oeuvres ouvertes, le site de Laurent Margantin)
_
On pourrait dire Ceci n’est pas une table en clin d’œil à Magritte, car La Table se multifonctionne, abri, radeau, bureau, lit conjugal, et bien plus encore.
–
« ELLE
Nous somme en train de choisir cette table….
LUI
Comment savoir ce qui se serait passé si nous n’avions pas acheté cette table ?
ELLE
On ne peut pas savoir. Ce qui est arrivé, c’est là. Toute notre vie est là, qui s’est construite à partir d’ici, de cette table, nos enfants, ta carrière dans la Compagnie, la crèche, la création de ton entreprise, mon retour au bureau, la mort de ta mère, la maladie de mon père, tes maîtresses, mes deux amants, nos placements foireux à la bourse, l’accident cardiaque de mon père, l’école primaire, le collège, le lycée, le Bac, la fac… »
–
ELLE et LUI, deux personnages, sur la scène d’un théâtre que Claude Ponti réquisitionne. Passe l’accessoiriste qui prend la parole, indique, apporte une lampe et des éclaircissements, déplace les chaises, tourne, tire, pousse la table selon la direction à prendre, la retourne, pieds en l’air, pour qu’ELLE et LUI l’enjambent et y prennent place. Et c’est Voyage avec La Table, leur vie en totalité, à tous les âges. Ils sont des enfants, ils sont des parents, un couple qui crie, s’interroge, s’extasie, soumis aux bruits et annonces publicitaires/baisses des marchés/compétitions/ rêves/ examens et tout ce qu’un quotidien peut contenir.
La Table trône en totem au centre de la scène, répercute par sa taille hors norme les événements hors norme qui font de nos vies ce qu’elles sont. Et c’est joyeux, atroce, poétique. Ils s’arrachent les cheveux, ils s’aiment, se pensent, s’éloignent, se réconfortent, enterrent leurs parents, jouent, regardent la télévision, se risquent à l’incompréhension mutuelle, se moquent de la mort vacharde, la subissent, ne se gênent pas pour grimper aux rideaux ou dénoncer le pire, éprouvent leur condition humaine par tous les bouts qu’ils peuvent attraper, aussi par ceux qu’ils reçoivent comme des claques.
La Table est solide, complexe, il y a des nœuds à l’intérieur du bois et des moments de grâce, de crasse, de rires. Ça se passe sur scène, et le théâtre c’est nous en condensé. Avec des étourneaux qui volent comme un banc de sardines, des pierres de noyade, des « tout le monde sont mort », des « océans enfermés dans une seule vague », une virago, des ortolans, du verglas sur les places boursières, des comptes à rebours, une incinération, des horaires de bus, un tissu de banquette, un suicide, des « nom d’un cul carré », des ratages, des arbres singuliers, le chat des voisins, une manivelle qui grince et un RIDEAU !
–
La Table de Claude Ponti sur Publie.net, avec dessins originaux de l’auteur, epub créé par Gwen Català, première mise en ligne le 12 novembre 2011
(chronique initialement parue sur Oeuvres ouvertes de Laurent Margantin)
–
Mort d’un père est un chemin non linéaire – avec bifurcations, hésitations et retours en arrière, prise à bras le corps, tensions et interrogations – vers un père qui vient de mourir.
Le prenant à parti parfois, la balance entre tu et il augmente la sensation de tâtonnement vers l’autre, ce père et sa face inconnue, les preuves de son existence que l’écriture exhume, photos d’enfant et séjours à l’hôpital.
« Sa visite du dimanche ne s’éternisait guère, « Bon je vais y aller ». Tu n’avais pas encore cassé tes os, et le vin du midi ajoutait à ta marche toujours incertaine, car déjà quand tu arrives un parfum de bière tournaille autour de ta bouche. Alors je disais « je vais te raccompagner », et nous descendions vers le parc
et je cherchais les mots
que tu ne cherchais pas. »
C’est un texte mystérieux par sa forme : fragmentaire, il ne donne pourtant pas l’impression d’être morcelé. Lançant des fils vers des photographies, souvenirs, paroles de chanson, extraits de contes, lignes poétiques, constats, il s’en dégage au contraire une grande continuité, due sans doute à l’intensité de l’acte, à cette volonté de happer, creuser et saisir la vie/la mort du père. Une volonté de s’y inscrire, de trouver et formuler enfin sa place propre au bout d’une lignée brisée à laquelle une femme incontournable (Eugénie) a imprimé sa marque.
La figure du père est questionnée à tous les temps : temps de l’enfance, échos et traces, temps adulte, de l’activité, temps de la déchéance, volontés, tics, négligences, et les objets qu’il a amassés se dessinent, nous questionnant aussi. Que faire des vêtements et meubles, du contenu des armoires, des assiettes, des statuettes ? Par quel bout attraper cette vie, sur quelle facette prendre appui, visage rebelle ou silencieux, joie ancienne, cadeaux, réparties, éloignements ?
« Entre la salle à manger et ta chambre, dans cet espace d’entre-deux où si longtemps j’avais dormi sur un canapé qu’il fallait replier au matin pour gagner de la place, s’entassaient tes vêtements en colline. Impossible de les affronter à mains nues, l’assaut me sembla inégal, ce n’était plus des pulls, des pantalons fatigués qui s’amoncelaient devant moi mais l’immensité de ta fragilité : tu ne pesais plus rien, dépouillé de ce que tu avais porté. »
Les visages du père changent selon l’époque et les aléas quotidiens. Martine Rousseau semble non pas empiler ces figures, mais les lier ensemble, les digérer. En écho, elle se fait sa propre addition de réponses à ces visages multiples : résignations, colères et incompréhensions, espoirs, tendresse immense.
« Il était monté sur un haut tabouret, et devant lui la glaise, grise, tournait entre ses mains arquées, prenant parfois pour modèles des têtes en bois de paysans au nez proéminent qui les faisait sembler à des caricatures. Il y eut des céramiques assemblées en carrés, disparues avant de parer quel mur ou sol imaginaires ? ce vase à la gueule striée de six lignes sombres et au col renflé, où des taches rougeâtres enfonçaient leur matière brillante dans le noir,
le vase-femme ocre aux bras en longs boudins s’arquant pour atteindre les hanches, et comme deux poire pourpres sous un cou sans tête serré de noir en coulée sur le dos, juste un trou pour des fleurs que je n’y vis jamais »
Mort d’un père, ancré dans une époque, peu à peu devient atemporel, comme si le dernier visage du père devenait atemporel, se délitait, figure de sable, comme s’il ne pouvait plus être saisi que par bribes et effilochements. Ce chemin d’écriture à sa rencontre nous renvoie, nous lecteurs, à nos propres histoires, aux traces laissées, leur permanence et leur fragilité de fleurs séchées, nos empreintes et celles des nôtres, ou ce qu’il en reste.
« Plus loin, au-dessus de ses morts bien à elle, une femme a sorti chiffon de feutre et flacon de cire, jalouse de l’unique arrosoir laissé près des poubelles, accroupie puis à quatre pattes elle frictionne, frictionne une Vierge de métal vissée, puis le caveau comme un parquet de bal. Nous n’irons pas danser sur le tien, non, j’y laisse tomber de ces sortes de minuscules pommes lâchées des arbres alignés de l’autre côté du mur qui te protège des voitures qui passent et des chiens qui pissotent. Les fruits de poupée viennent rouler entre les lianes qui un jour, je l’espère, auront dévoré ta pierre, que plus rien ne vienne rompre le sol de terre, rien des sculptures en série, rien que le sol ondulé de doigts d’herbes de plus en plus longs. Bon sang, que la pierre se dissolve, que les morts ne fassent plus volume. »
Mort d’un père de Martine Rousseau, chez Publie.net
chronique initialement parue sur le site de Laurent Margantin Œuvres Ouvertes, voir son Rendez-vous de lectures numériques chaque 1er du mois
« pourquoi ce désir de t’écrire toi qui n’es pas, y trouverai-je ainsi à exister moi-même enroulant ma phrase autour du ventre d’ombre »
C’est un exercice perdu d’avance de vouloir rendre compte / présenter / simplement dire un texte de Jacques Ancet, exprimer cette capacité qu’il a de fonctionner en cercles concentriques jusqu’à une moelle commune à tous mais que personne n’avait atteinte comme il le fait, avec cette méticulosité du mot, cet abandon et cette acceptation de laisser monter en soi ce qui bouleverse.
La Tendresse, une litanie poétique, de très longues phrases et peut-être une seule phrase coupée par de petites respirations qui forme des pans ou des parties, centrées autour d’un « un » ni nommé, ni défini.
D’entrée, on partage une sorte de gestation mystérieuse, ce serait le dialogue secret d’une femme enceinte avec un « un » diffus. Puis se poursuit l’étirement de ce fil qui lie le « un » à soi, et La Tendresse s’explore dans cette capacité à surmonter la séparation, à en déjouer les vides et les trous noirs quand le « un » devient autre que soi mais pas seulement et pas vraiment entièrement, ces moments où l’on peut réussir à conserver des bribes, la gratitude exprimée à la vie, sous-jacente.
Des pensées qui traversent ce que voit le regard et ce qu’entend l’oreille, cris d’enfants, l’espace de la nuit, des figures maigres et misérables, dans la tête posée sur la main, dans le geste d’écrire, « les mots sont une lente procession d’insectes, j’entends leur grésillement ».
Chaque angle approché de La Tendresse pourrait devenir citation. Jacques Ancet provoque l’envie de noter, de revenir sur sa parole lentement, longuement. Au milieu du rythme ample de ce texte, de petits poèmes sourdent, pourraient s’extraire et vivre seuls :
« j’écoute la nuit, sa voix emplit les chambres de terreurs lointaines »
« l’instant est un mot arrêté que je regarde longuement sans le comprendre »
« un vide clair comme une plage très tôt le matin »
« j’écris pour que le temps m’emporte, ne meure pas sans moi, mots du petit poucet »
La Tendresse chercherait – c’est ma lecture, elle est sans doute bien limitée – le chemin vers ces moment indicibles où se palpent l’évidence de l’existence complète au monde, tous les sens tendus vers cette fraction d’infini, la finitude présente aussi, la capture de l’éphémère, sa brillance.
« je vous contemple, en cet instant vous êtes immortels, une seule fois et pour toujours, je ne sais pas écrire cette merveille mais je la cherche »
Non, réellement, c’est un exercice perdu d’avance pour moi de vouloir présenter un texte de Jacques Ancet, sans passer par la multiplication des extraits pour montrer la matière, belle, ondulante et dure. Sans finir par une injonction presque impatiente, à en taper du pied sur le sol, mon impuissance à dire autre chose que Lisez, lisez Jacques Ancet.
« tes yeux étranges, soudain, qui me fixent ou ce contact encore de ta main dans la mienne, la mouche s’obstine, le temps coule de mes yeux, de mon nez, de ma bouche, de chaque pore, je sue du temps, j’en pleure, un fleuve invisible m’entoure, silence, tiédeur des corps, bonheur instantané, la mer est d’un bleu d’enfance, mouettes et lumière, je respire doucement, cherchant toujours, suspendu à un fil, perdu, chaque jour, recommençant, le laurier le vent et toi qui demandes, comment on écrit clé, j’épelle c l, oui, é accent aigu, c’est ça, c l é accent aigu, suivant des yeux un gros insecte errant de fleur en fleur »
La Tendresse de Jacques Ancet, en livrel sur Publie.net